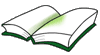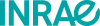|
Résumé :
|
Près de 100 espèces sont connues pour être présentes dans le domaine intertidal (estuaires, marais salés et vasières) de la baie du Mont Saint-Michel (France). Entre mars 1996 et avril 1999, 120 marées ont été échantillonnées dans les chenaux des marais salés macrotidaux. Au total, 31 espèces ont été capturées. Ce peuplement est largement dominé par les mulets (Liza ramada représente 87% de la biomasse totale) et les gobies (Pomatoschistus minutus et P. lozanoi représentent 82% des effectifs totaux). Ces espèces ainsi que Gasterosteus aculeatus, Syngnathus rostellatus, Dicentrarchus labrax, Mugil spp., Liza aurata et Sprattus sprattus sont les espèces les plus fréquentes. En Europe, les marais salés et leurs chenaux ne sont inondés que lors des marées de grande amplitude. Par conséquent, les poissons ne peuvent envahir cet environnement que lors de courtes périodes d’immersion et aucune espèce ne peut être considérée comme résidente des marais salés. Toutefois, cette zone humide est colonisée par l’ichtyofaune lors de chaque marée pénétrant dans les chenaux et durant cette faible période, ils s’alimentent activement et exploitent la forte production primaire et secondaire. L’alimentation des mulets est composée d’une mixture de sédiments, de détritus des halophytes des marais salés, de micro-invertébrés benthiques et de diatomées benthiques. Les gobies et les jeunes bars consomment les macro-invertébrés et plus particulièrement Orchestia gammarellus, un crustacé résident des marais salés. Cette communauté ichtyologique apparaît alors comme un transporteur de matière organique entre les marais salés et les eaux marines côtières et peuvent alors jouer un rôle significatif dans les budgets globaux en énergie des environnements côtiers comme la baie du Mont Saint-Michel. Nous avons aussi montré que ces marais salés peuvent être responsables d’une part importante de la croissance des jeunes bars du groupe 0 (entre 40 et 60% de leur croissance pondérale). Ces résultats confirment l’idée générale que ces zones humides jouent un rôle trophique et plus particulièrement de nourricerie significatif pour ces espèces euryhalines. Les différences de densités et de structure de population de ces espèces à l’intérieur de l’écosystème Mont Saint-Michel (vasières, tidales, estuaires et marais salés) réduisent les possibilités de compétitions trophiques. Mais, au sein de cette baie, les ¾ des marais salés sont intensément pâturés par les moutons. Cet usage agricole cause d’importants impacts sur les structures d’habitats, spécialement pour O. gammarellus. Dans les zones pâturées, ce crustacé est alors remplacé par d’autres items alimentaires et les petits poissons prédateurs consomment moins. Par conséquent, les rôles trophique et de nourricerie des marais salés européens pour les poissons sont réduits. Cet exemple illustre que l’aménagement d’une zone pour promouvoir un composant de la biocénose peut avoir des répercussions négatives importantes pour d’autres espèces.
|