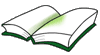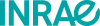|
Résumé :
|
La métropole contemporaine a-t-elle détrôné la ville ? D'après les diagnostics bien en vue, la mondialisation des économies et le triomphe des réseaux ont englouti la ville sous la marée de l'urbain. La "ville globale" du XXIe siècle, magma urbain sans lieux ni bornes, a fait craquer l'ordre du territoire. Tout spécialement, elle a discrédité notre carte politique et administrative. Une géographie technologique des réseaux va-t-elle la supplanter ? Si l'espace français et celui des agglomérations sont en pleine recomposition, ces mutations s'inscrivent avant tout dans le cadre d'institutions auxquelles s'ajustent les coopérations et les concurrences des acteurs de la scène urbaine. Loin de symboliser un archaïsme, ces structures institutionnelles font preuve d'une étonnante modernité. Quitte à décevoir les adeptes de la ville-entreprise ou de la métropole en réseau, le tissu communal, les départements et les régions constituent les espaces de décision et de légitimité de l'organisation territoriale. Conjointement avec ceux de l'Etat, les choix de ces collectivités publiques continuent de dessiner, comme par le passé, les traits saillants de notre géographie. Cette reconnaissance de la primauté du fait politique et institutionnel invite à ne pas surestimer les illusions technologiques ou les déterminismes simplistes célébrant l'avènement d'une "ville en archipel" assujettie à la montée de l'individualisme et aux lois du marchés. Une telle perspective trace la voie d'une économie politique de la ville qui interroge le devenir de l'espace social urbain à travers les enjeux du renouveau de la cité démocratique, de la responsabilité publique et de la citoyenneté.
|