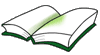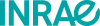|
Résumé :
|
Le fleuve Loire a généré un paysage essentiel en France, tant en terme d'occupation humaine, d'aspect, que de représentations et de place dans l'histoire même du concept de paysage. Il est aussi, comme la plupart des motifs naturels en Europe, l'objet de discours sur la séparation d'avec l'homme, ce qui pose en corrélation des problèmes de gestion, et simplement d'entretien. Quatre mouvements participant à la construction du paysage sont habituellement retenus dans les recherches : géographique, artistique (peinture et pour la Loire surtout littérature), touristique et politico-administratif. Ils sont explorés dans un premier temps à une échelle globale, qui met en évidence le jeu de deux grands modèles, fonctionnant comme deux pôles dans le discours : une Loire royale, à aménager, policée; et une Loire sauvage, à ménager, écologique. Le souci de rechercher la spacialité de ces modèles, afin de répondre géographiquement à la question des problèmes d'entretien, conduit à ré-envisager ces modèles en les confrontant d'une part à la réalité de l'occupation humaine le long du fleuve (démographie et occupation du sol), d'autre part aux discours et aux pratiques des riverains, des habitants, par rapport aux représentations dominantes des quatre mouvements précedents. On est ainsi passé à une échelle locale, qui offre finalement une autre apporche du concept de paysage, par le bas, dont les résultats sont des représentations de nature différente. Si modèle local il y a, il s'agit d'une Loire sauvage au sens de vivante, non mécanique, mais auquel l'homme participe et dont il est responsable. La mise en oeuvre d'une méthodologie pour appréhender cette échelle locale aboutit à tenter une géographie des préférences paysagères qui pourrait aider les aménageurs dans leurs démarches de gestion ou leurs projets touchant aux paysages.
|