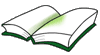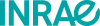|
Résumé :
|
Jusqu'à présent, une importante prépondérante a été donnée à l'histoire sismique dans les évaluations d'aléa sismique. Ceci est justifié si l'échantillon de séismes historiquement recensés dans une région est réellement représentatif de son activité sismique pour la période de temps considérée, et si l'on admet que les séismes majeurs surviennent uniquement là où ils se sont déjà produits. Ce postulat est vérifié lorsque les relations sismotectoniques sont bien établies comme dans les régions de frontières de plaques bien localisées (zone de subduction, système transformant) et/ou à taux de déformation élevé. Par contre, dans les zones à déformation diffuse et relativement modérée, la période historique (quelques centaines d'années) ne représente pas un laps de temps suffisant pour observer un échantillon de sismicité représentatif de l'activité tectonique actuelle. Il convient donc d'accorder un poids plus important à une approche globale et pluridisciplinaire du risque sismique, combinant différentes techniques (néotectonique, télédétection, géodésie, étude des champs de contraintes et de déformation actuels, tectonique des plaques, paléosismologie, etc...) qui fournissent un recul par rapport aux seules données de la sismicité historique ou instrumentale. Pour la première fois, une telle approche fondée sur l'étude et la synthèse de données géologiques et sismologiques fiables, est proposée. Elle procure un cadre sismotectonique cohérent et homogène pour l'ensemble de la France métropolitaine et les régions limitrophes. Un effort particulier a été fait pour la collecte et l'analyse des données de la tectonique actuelle et récente. Le zonage sismotectonique présenté prend en compte les principales caractéristiques tectoniques et sismotectoniques représentatives des hétérogénéités de la croûte continentale et de l'activité sismique.
|