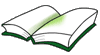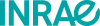|
Résumé :
|
L'objet de cette thèse est de mettre en évidence les déterminants microéconomiques de la périurbanisation, celle-ci étant définie comme mouvement de relocalisation d'actifs, qui choisissent une localisation résidentielle rurale à lieu d'emploi urbain. Cela nécessite de mettre en oeuvre une analyse des choix résidentiels des ménages d'actifs. On fait appel aux analyses du choix d'un statut d'occupation dans le cadre de la théorie du cycle de vie, aux théories hédoniques du marché du logement et aux analyses de la mobilité résidentielle. Mais surtout, les choix de localisation résidentielle des ménages périurbains peuvent s'analyser dans le cadre des modèles de localisation résidentielle de la Nouvelle Economie Urbaine. Aux hypothèses de base de ces modèles, peuvent être ajoutées des hypothèses complémentaires. L'existence d'une différenciation spatiale de l'offre de logements, la prise en compte du temps de transport et des attributs des lieux font partie des hypothèses qui permettent d'aboutir à un schéma d'analyse des localisations résidentielles périurbaines. Au centre de ce schéma d'analyse, un modèle de localisation résidentielle spécifique est construit sous forme d'un système d'équations simultanés, dont les estimations ont pour but de mesurer la part, dans le mouvement de périurbanisation, du poids des différents déterminants. L'ensemble du schéma d'analyse est alors confronté aux faits, à partir de données statistiques issues de l'Enquête Logement 1988 de l'INSEE. A l'échelle des zones périurbaines, on montre le rôle de la taille du centre dans la détermination des valeurs foncières. La distance de localisation des ménages serait fonction de leur niveau de revenu, l'augmentation du revenu induisant dans un premier temps un éloignement du centre puis, après saturation de la demande de logement, un rapprochement . Mais elle serait aussi la conséquence de demandes différenciées de terrain attenant au logement et d'équipements collectifs.
|